Maryjane
Super Posteur
Inscrit le: 25 Mai 2005
Messages: 3244
Localisation: Derrière toi
|
 Posté le: Mar 23 Mai 2006 12:12 Sujet du message: Posté le: Mar 23 Mai 2006 12:12 Sujet du message: |
 |
|
J'ai peut-être pas trop bien cerné mais voici ce que j'ai trouvé :
 Dossiers sur les logiciels libres Dossiers sur les logiciels libres
 Distributeur officiel de Red Hat Linux en Afrique Distributeur officiel de Red Hat Linux en Afrique
 Plusieurs sources sur l'informatique pour la zone Côte d'ivoire Plusieurs sources sur l'informatique pour la zone Côte d'ivoire
Ainsi que :
| Citation: |
http://www.01net.com/article/256102.html
L'Afrique vote pour le libre
Pour le continent noir, les logiciels libres représentent l'espoir de ne pas être exclu de la société de l'information. Ils ouvrent aussi des perspectives de formation et de création d'activité commerciale.
Philippe Davy , 01 Informatique, le 22/10/2004 à 00h00
Le logiciel libre comme outil de développement des nations. Les utilisateurs et les pouvoirs publics ont mis en avant ce lien étroit lors des premières rencontres africaines des utilisateurs de logiciels libres à Ouagadougou (Burkina Faso), au début du mois d'octobre. La bonne ambiance ne cache pourtant pas la gravité de l'enjeu pour les pays africains francophones et, au-delà, pour le continent entier. La promotion des TIC est désormais au coeur des préoccupations des dirigeants. Et même dans les pays les moins avancés, comme le Burkina Faso. « Nous devons donc faire preuve de plus de créativité que les autres. Il nous faut faire des choix technologiques compatibles à la fois avec nos ressources et nos engagements internationaux, notamment en matière de propriété intellectuelle et de droit d'auteur » , argumente Justin Thiombiano, le ministre des Postes et Télécommunications burkinabé. Dans ce pays, en effet, une licence Windows coûte seize fois le salaire mensuel minimum garanti. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable d'assurer un accès démocratique équitable aux outils et techniques d'information sans recourir aux logiciels libres.
Pas les moyens de renouveler les licences
La logique du développement communautaire de logiciels demeure une source d'interrogations pour beaucoup, même si sa compréhension progresse. « En 1997, l'administrateur du site de l'Université de Ouagadougou a remplacé un serveur Linux offert par l'Agence de la francophonie par un serveur Windows NT, rappelle Pierre Ouedraogo, responsable de projets de l'Intif, un département de l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Aujourd'hui, il utilise plusieurs serveurs Linux, dont il est très content. »
Les éditeurs traditionnels, Microsoft en tête, multiplient les accords ponctuels avec les gouvernements, au titre de l'aide au développement. Ainsi, des PC fonctionnant sous Windows ont été livrés dans le cadre du programme d'aide américain USAid pour équiper les écoles de différents pays. « Problème : au bout d'un an, nous devons renouveler les licences, mais nous n'en avons pas les moyens » , indique un responsable burkinabé.
La conscience de l'importance des logiciels et de la capacité à les concevoir localement est très aiguë dans les pays africains francophones. En relation avec leurs partenaires anglophones, ceux-ci veulent définir une position commune pour promouvoir l'utilisation des logiciels libres au niveau planétaire, dans le cadre des discussions sur la société de l'information. « Nous avons manqué les deux premières révolutions de l'ère moderne : l'agricole et l'industrielle. L'Afrique ne saurait être en reste dans la société de l'information », affirme Mamadou Decroix Diop, ministre de l'Information, de la Communication et de la Promotion des technologies de l'information du Sénégal.
De l'avis général, l'utilisation de logiciels propriétaires, si elle se révèle pratique, n'en place pas moins les pays africains en position de simples consommateurs de technologies, sans réelle capacité à promouvoir leurs spécificités. Sans même parler des moyens nécessaires, puisque les « cadeaux » initiaux s'avèrent le plus souvent hors de prix, en raison des coûts des mises à jour.
Les brevets logiciels, une source d'inquiétude
Alors que la coopération internationale se fait de plus en plus discrète, les pays africains doivent imaginer des solutions avec un minimum de moyens. La stratégie doit être en adéquation avec les ressources à disposition. Ainsi, selon Mamadou Decroix Diop, « le gouvernement électronique n'existera en Afrique que grâce au logiciel libre » . Il mise sur ces derniers pour réduire, voire résorber la fracture numérique Nord-Sud. Cela implique sans doute une remise en cause des habitudes de consommation en matière de logiciels. Et le ministre de plaider pour que chaque entrepreneur puisse décider en toute connaissance de cause d'utiliser de manière prioritaire les logiciels libres non pas seulement pour minimiser les coûts, mais aussi pour contribuer au développement de l'industrie locale du logiciel. « Il ne faut pas que les échanges entre les hommes se limitent à des rapports marchands. Les logiciels libres sont le moteur mondial de l'utilisation de standards ouverts permettant la transparence. Les citoyens doivent continuer à exercer leurs droits démocratiques, notamment dans la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme linguistique. »
La question des brevets appliqués aux logiciels, qui se pose de façon conflictuelle en Europe, préoccupe au même titre nombre d'Africains. Lors des Rencontres, la session consacrée à ce problème, animée par François Pellegrini, professeur à l'Université de Bordeaux 1, a été suivie avec un grand intérêt. L'inquiétude est vive, face au choix européen proposé d'entériner de facto les pratiques américaines et japonaises sur les brevets logiciels. « Des dispositions législatives devraient être élaborées, à l'échelle des différents pays, pour garantir la pérennité des projets libres et les exclure du champ de la brevetabilité », soutient le docteur Abdoulaye Salifou, directeur du campus numérique francophone de Bamako (Mali), approuvé par l'assemblée. Autre question soulevée, l'existence d'un modèle économique spécifique pour les acteurs africains du libre. Alors qu'Alexandre Zapolsky, PDG de la SSLL française Linagora, vante un modèle basé uniquement sur les prestations de service, la réalité africaine oblige la plupart des acteurs à faire coexister leur activité dans le libre avec la vente de logiciels propriétaires. Ceux-ci préservent souvent dans l'esprit des clients une image de stabilité dont ne bénéficient pas encore les logiciels libres. Certaines sociétés contournent l'obstacle en commercialisant des serveurs Linux en mode « boîte noire » , misant sur l'avantage tarifaire conféré par le système d'exploitation libre. Ou encore assurent l'entretien et la maintenance de matériels, comme la SSII Assist en Côte-d'Ivoire. « Nous nous heurtons à l'ignorance des décideurs au sujet du libre, explique Christian Roland, PDG d'Assist. Parce que ces logiciels sont perçus comme gratuits, il est difficile de faire passer l'idée de services payants. » La solution passe par des packages et aussi par la vente de logiciels propriétaires.
La plupart des sociétés informatiques sont également fournisseurs d'accès à internet ou développent des progiciels spécialisés, comme par exemple la SSII malgache Orchid Systems dans la micro-finance. Cette société est née en juillet 2000, en tant que fournisseur d'accès et afin d'assurer à la fois le développement de logiciels de gestion et des services de support sur des logiciels libres. Hajanirina Ramboasalama, son directeur général, constate encore un manque de ressources humaines qualifiées, car les besoins sont bien présents et le marché réel. Recommandations des participants : il faut développer les ressources humaines dans tous les secteurs grâce aux logiciels libres, qui jouent un rôle très important pour la formation par leur aspect ouvert, et insérer leur enseignement dans les différentes filières. Et surtout, mener une campagne d'information à grande échelle sur le continent.
Favoriser la création de contenus africains
Malgré la petite taille des entreprises en général, le libre remporte des succès, souvent en milieu scolaire ou universitaire, mais aussi dans quelques projets d'envergure. Ainsi, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) s'est engagée avec succès dans un plan de migration de deux cent cinquante serveurs vers Linux, tandis qu'elle installe la suite bureautique OpenOffice sur deux mille cinq cents postes de travail équipés de Windows ou de Linux. Côté éducation, des solutions apparaissent, comme Baobab Edu, une adaptation africaine de la solution destinée aux établissements scolaires Abuledu, qui se développe au Sénégal et au Mali. « Dans ce cadre, il faut favoriser la création de contenus africains tenant compte du pluralisme linguistique, explique Pierre Ouedraogo en conclusion de ces journées. Ici, il n'est pas encore exploité, mais nous avons pas mal d'associations et de nombreuses actions en cours. Il faut aussi limiter les dépenses de développement. Beaucoup de pays, en Amérique latine ou en Asie, commencent à prendre ce chemin. »
Dans ce contexte, le logiciel libre s'installe progressivement en Afrique. Il entre en résonance avec une culture où le partage est une vieille habitude, où les biens sont souvent communs, et avec l'enthousiasme des Africains en quête d'autonomie. Aussi, la question n'est plus pour eux de savoir s'il faut aller vers le libre, il n'y a même plus débat, le choix est entériné malgré la pression des éditeurs. La vraie question est de savoir à quel rythme, avec quels moyens, en s'appuyant sur quelle volonté politique et quelle sécurité juridique.
L'ONU et la société de l'information
Organisées entre deux étapes du SMSI (Sommet mondial pour la société de l'information), ces rencontres africaines visaient à définir les contours d'une contribution africaine commune dans ce grand débat mondial. L'objectif des Nations unies était d'identifier des lignes d'actions pour réduire, voire résorber le gouffre croissant entre les riches pays du Nord et les pays émergents, qu'ils soient en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. L'organisme mondial est déjà engagé dans une promotion active de Linux et des logiciels libres, de même que l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire des Rencontres de Ouagadougou. « La première phase du sommet, à Genève en 2003, n'a pas abouti à un consensus, regrette Mamadou Decroix Diop, le ministre de l'Information sénégalais. En préparation de la deuxième phase, en 2005, nous devons engager une réflexion qui débouchera sur une position claire, convergente avec celle des pays anglophones, qui font souvent les mêmes constats que nous. » |
_________________
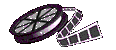 Les Toiles de Maryjane Les Toiles de Maryjane
 |
|









