
|
 |
  |



 |
|
 |
|
 |
 |
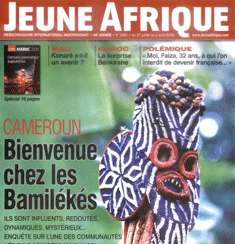 |
 |
 |
|
 |
 |
La couverture de ''Jeune Afrique''
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

L’hebdomadaire Jeune Afrique consacre sa une et un dossier de six pages aux Bamilékés, un peuple constituant une grande partie de la population camerounaise dans son numéro 2481. En couverture, on peut lire : "Ils sont influents, redoutés, dynamiques, mystérieux...Enquête sur l’une des communautés les plus admirées mais aussi les plus controversées d’Afrique centrale". Inutile de dire que Jeune Afrique va réaliser une de ses meilleures ventes de l’année au Cameroun…
Reste qu’après lecture du dossier, le lecteur averti sera déçu et restera probablement sur sa faim. Certains pourraient même se sentir floués après une présentation si accrocheuse en couverture. Le profane par contre, non camerounais de préférence, y trouvera peut-être son compte.
En effet, toute personne qui a déjà entendu parler des bamilékés sort du dossier sans vraiment mieux comprendre en quoi cette communauté est "mystérieuse", ou pourquoi elle serait "redoutée". Que les bamilékés soient réputés avoir le "sens du commerce", qu’ils utilisent les "tontines" comme mode d’épargne ou d’entrée dans les affaires est de notoriété publique et n’est pas vraiment une information en soi. Qu’une éventuelle accession au pouvoir politique de certains d’entre eux ne suscite pas l’enthousiasme de tout le monde n’est pas nouveau non plus.
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
L'entrée d'une chefferie dans un village bamiléké
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

Un des intervenants interrogé par Jeune Afrique explique le fait que les "rares partis d’opposition dirigés par les bamilékés aient un poids électoral insignifiant" par le système des chefferies. (Schématiquement, les bamilékés sont formés de sous groupes où les chefs traditionnels gardent un certain prestige et les fédérer exigerait de fédérer les chefferies ?).
Cette affirmation concernant les partis politiques sous entend aussi que les bamilékés auraient du adhérer à ces partis lancés par "un des leurs". Ne faudrait-il pas surtout se poser la question de savoir si les leaders de ces formations politiques ont les capacités requises pour fédérer, convaincre, s’ils ont un projet politique viable de nature à intéresser les camerounais (et pas seulement les bamilékés comme il est sous entendu dans l’article), et s’ils se distinguent de l’apathie habituelle de la classe politique camerounaise...
Selon Jeune Afrique "s’ils n’ont pas de partis qui comptent, ils [les bamilékés] détiennent une bonne partie des médias". Une autre affirmation qui aurait mérité un plus long développement dans l’article, et pouvant être sujette à controverse est la suivante : "Leurs succès dans le domaine des affaires doivent beaucoup au président Ahidjo, qui, au début des années 60, encouragea la formation d’une bourgeoisie dans cette communauté en échange des luttes dans les maquis de l’UPC. C’est de cette alliance que les André Sohaing, Joseph Kadji Defosso et autres Victor Fotso tirèrent leur réussite".
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Un notable bamiléké en costume traditionnel
©
camerounphotos.afrikblog.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

S’il est vrai qu’Ahidjo (premier président du Cameroun NDLR) encouragea la constitution d’une bourgeoisie camerounaise, la contrepartie politique qui serait l’arrêt de la lutte de l’UPC dans le maquis semble beaucoup moins évidente à percevoir, puisqu’elle s’est poursuivie dans le maquis jusque dans les années 70 (Ernest Ouandié, le dernier leader historique des upécistes fut fusillé sur la place publique en janvier 1971).
Dans sa biographie, "Le chemin de Hiala", l’homme d’affaires bamiléké Fotso Victor (qui passe pour être l’homme le plus riche du Cameroun), qui avait déjà connu une belle réussite dans le commerce, attribue son entrée dans le monde de l’industrie à un coup de pouce d’Ahidjo, qui voulait le remercier d’avoir aidé à accueillir des personnalités présentes au Cameroun lors d’un sommet international. Mais le point crucial de son ascension est surtout selon Fotso Victor le tandem improbable que l’autodidacte qu’il était avait formé avec un polytechnicien français du nom de Jacques Lacombe, chef d’entreprise très compétent. Ce dernier l’aida à structurer, à bâtir et à développer ce qui allait devenir le groupe Fotso (industrie, immobilier, banque etc).
|

On peut aussi regretter que "Jeune Afrique" n’ait interrogé, étrangement, aucune des "têtes d’affiches" mise en exergue dans son dossier. Les hommes d’affaires bamiléké de l’ancienne génération, pour l’essentiel autodidactes, auraient certainement pu fournir un éclairage intéressant. [Il ne faut toutefois pas écarter l’hypothèse qu’approchés par l’hebdomadaire, ils aient décliné la proposition de s’exprimer sur un sujet qui peut être "sensible" au Cameroun NDLR.] Ceux de la nouvelle école, qui ont fréquenté les universités et grandes écoles, souvent en Occident, auraient pu expliquer l’évolution, voire la mutation de la pratique des affaires chez les têtes d’affiches bamilékés.
Par ailleurs, Jeune Afrique oublie de mentionner une chanson que Meiway avait consacré aux bamilékés en 2005 ( "bami power"), et surtout, une phrase fameuse, attribuée à l’ex-président ivoirien Félix Houphouët Boigny qui aurait dit un jour : "Donnez moi les bamilékés et je ferai de la Côte d’Ivoire un pays développé". On peut encore souligner une phrase d’un ancien responsable politique français à leur propos : "une belle ethnie" (!). En conclusion, il faut néanmoins rappeler qu’au delà de la réussite des hommes d’affaires bamilékés, la plupart des bamilékés ne vivent pas mieux que le reste des camerounais pour qui la vie quotidienne demeure un combat permanent. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant...
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
| |
 Donnez
votre opinion ou lisez les 48 réaction(s) déjà écrites Donnez
votre opinion ou lisez les 48 réaction(s) déjà écrites
 Version
imprimable de l'article Version
imprimable de l'article
 Envoyer
l'article par mail à une connaissance Envoyer
l'article par mail à une connaissance
Partager sur:
 Facebook Facebook
 Google Google
 Yahoo Yahoo
 Digg Digg
 Delicious Delicious
|
| |
| |
Les dernières photos publiées sur Grioo Village |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
 Top
Top |
| |
| |
|
| |
| |
|
  |
 |

|
|