
|
 |
  |




Resituons le contexte : Fin des années 70-début des années 80, l’Afrique centrale baigne dans une douce euphorie. Les découvertes récentes au Gabon, au Cameroun et au Congo font de ces pays des « eldorado » pétroliers. Des projets pharaoniques sont construits çà et là et c’est aussi l’époque des grandes affaires plus ou moins douteuses : Affaire elf….
Mais comme toute richesse, la manne pétrolière s’épuise…notamment au cours des années 90 et les budgets des états en patissent. Si au Congo, un grand gisement (celui de Nkounga) permet d’entrevoir des perspectives meilleures, au Gabon mais surtout au Cameroun, les ressources se tarissent. Au même moment, des nouveaux gisements sont découverts dans des états voisins et avouons-le mésestimés jusqu’alors : Ils se nomment Guinée équatoriale et Tchad.
En quelques années et quelques contrats plus tard, ces pays sont en passe de devenir des « monarchies pétrolières ».
Depuis quelques semaines, un autre micro-état s’est ajouté à la liste : Sao Tomé et Principe
On peut donc se demander si les rapports de force sont entrain d’évoluer considérablement d’autant que ces nouveaux produisent désormais l’essentiel de la richesse nouvelle créée dans la sous-région ?
Analysons rapidement l’évolution de ces nouveaux pays récemment :
|
|
|
|
Sao Tomé et Principe : |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Fradique de Menezes, le président de Sao Tome et Principe
©
cstome.net |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

Une tornade de pétrodollars atteindra début 2004 l'archipel africain de Sao Tomé et Principe, fruit de la mise aux enchères de neuf blocs pétroliers offshore officiellement lancée en avril au
Nigeria. Cette manne de plusieurs dizaines de millions de dollars, pourrait multiplier par deux le budget annuel, estimé à 55 Millions de dollars, de ce pays du golfe de Guinée de 140.000 habitants, classé parmi les plus pauvres au monde.
"Au 1er trimestre 2004, nous devrions toucher l'argent de la vente des neuf blocs. Mis aux enchères à 30 M USD, cela fera 270 M USD si nous les vendons tous", a indiqué le ministre saotoméen des Ressources naturelles, Joaquim Rafael Branco.
"Certaines parcelles peuvent atteindre 100 millions", a-t-il estimé.
L'Etat saotoméen ne touchera que 40% de ces revenus, contre 60% pour le Nigeria, premier producteur africain d'or noir, conformément à un accord d'exploitation conjointe conclu en février 2001 entre les deux pays après l'échec de la délimitation de leur frontière maritime.
"Cela nous suffit", a commenté le ministre Branco.
Pour le pays du président Fradique de Menezes, la vente de ces parcelles d'eau salée constitue déjà une providence.
L'archipel dépend à plus de 80% de l'aide internationale et cumule 300 millions de dollars de dette extérieure. Après cinq siècles d'agriculture (canne à sucre, café, cacao), le produit intérieur brut (PIB) par habitant plafonne à 450 USD en 2002.
|
|
Guinée Equatoriale |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Le président de la Guinée Equatoriale, Téodoro Obiang Nguema
©
winne.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

La Guinée Equatoriale voisine, est détentrice du record mondial de croissance en 2001 (70%), grâce à un boom pétrolier entamé il y a 10 ans. En 2002, la croissance a été de 16,5%, et elle est attendue encore en hausse de 14% cette année. De plus avec un PIB/habitant de plus de 5000 euros annuels, le pays est bien devenu un eldorado et se permet même de financer ces voisins. Le général Bozizé, le nouvel homme fort en république Centrafricaine n’est-il pas venu en début de mois solliciter la « poursuite de la coopération entre les deux pays » qui selon nos sources consistait essentiellement à une aide financière de 1,5 millions d’Euros (1 milliards de FCFA) du régime du président Obiang Nguema envers celui de Patassé.
Enfin, on note également un réchauffement des relations diplomatiques entre la Guinée Equatoriale et le Nigeria , puis Cameroun à l’instigation de ces derniers qui veulent ménager un voisin de plus en plus riche et qui pourrait par exemple financer des oppositions armées.
On le voit donc l’influence de la Guinée Equatoriale est sans cesse grandissante et ne fait que commencer pour certains analystes.
|
|
Le Tchad |
 |
|
 |
|
 |
 |
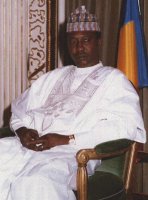 |
 |
 |
|
 |
 |
Le président tchadien, Idriss Deby
©
tit.td |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

La découverte des gisements de Doba ont représenté une manne financière providentielle pour ce pays enclavé. Le premier baril de pétrole sortira des puits dans quelques semaines seulement après la mise en place d’une infrastructure colossale, la plus importante jamais réalisée à l’intérieur du continent noir. La croissance économique est de ce fait en nette hausse ces dernières années (+7% en 2002), +9% attendue en 2003.
Les nouvelles recettes ont permis au pays du président Deby de s’affranchir provisoirement de la tutelle envahissante de la libye.
Le pays développe également une influence grandissante auprès des pays voisins particulièrement la république centrafricaine où il a participé activement à l’éjection de l’ex-président Patassé. Sur le front Ouest, une intense activité diplomatique avec les pays riverains du Lac Tchad (Nigeria, Niger, en tête) a lieu en vue de contenir une éventuelle opposition armée qui pourrait surgir
Tchad, Sao Tomé et Principe et Guinée Equatoriale sont les nouveaux fleurons de l’économie d’Afrique centrale (une croissance à deux chiffres y est attendue dans chacun de ces pays cette année). Ils y développent par conséquent une certaine influence politique à l’instar du Gabon au cours des années 70-80.
Justement que deviennent-les anciens ?
|
|
Le Gabon |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Le président gabonais, Omar Bongo
©
http://us-africa.tripod.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

Le Gabon est certainement le pays qui pâtit le plus de cette montée en puissance de la bande des trois.
Tout d’abord la croissance économique a été l’année dernière négative et en 2003, les économistes de la BEAC (Banque des états de l’Afrique Centrale) attendent une croissance nulle, conséquence de la forte baisse de la production pétrolière (Elle est passée de 18 millions de tonnes équivalents pétrole en 1997 à 12 millions en 2002).
L’état puise donc quelque peu dans sa cagnotte pour subvenir aux besoins d’investissement du pays, et le pays n’a plus les moyens de subventionner les gouvernements ou les oppositions africaines comme il le faisait autrefois.
Pire les relations entre le Gabon et la Guinée Equatoriale ne sont pas au beau fixe, elles étaient déjà exécrables avec le Cameroun, et elles sont devenues plus ambigues avec Sao Tomé, longtemps sous la tutelle du pays du président Bongo. Si son influence reste certaine dans la sous-région, elle est sérieusement et quotidiennement mise en péril à la suite de ses difficultés financières.
|
|
Le Congo |

Le Congo pense doucement ses plaies après la sanglante guerre civile qui a eu lieu à la fin des années 90. Les recettes pétrolières lui permettent essentiellement de s’atteler à la reconstruction du pays. Le pays ne semble pas être en mesure de jouer un quelconque rôle dans la sous-région.
|
|
Le Cameroun |
 |
|
 |
|
 |
 |
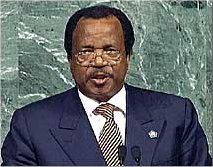 |
 |
 |
|
 |
 |
Le président camerounais Paul Biya
©
cnn.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

Enfin le Cameroun a vu sa production chuter dramatiquement au point de paraître aujourd’hui anecdotique. De plus le pays a une longue tradition depuis les années 80 de neutralité, voire quelque peu d’indifférence envers les évènements politiques de la sous-région. Cependant, cette position politique ne réduit pas pour autant son influence à zéro. Celle-ci et d’abord liée à sa position géographique : les principaux approvisionnements du Tchad, la RCA, du Nord du Congo ou du Nord du Gabon sont assurées depuis le port de Douala ou de Limbé. Ensuite, la diversification de son économie au regard de celle des autres pays et le dynamisme de sa population lui confèrent une influence de fait dans l’activité économique de ces pays (y compris la Guinée Equatoriale). Enfin, sa diplomatie réputée discrète, est aujourd’hui axée sur les pays comme la Guinée Equatoriale, le Nigeria dans la perspective d’un partage de la production pétrolière quelque peu abondante dans la sous-région.
|
|
Conclusion |

Au final, on le voit bien les rapports de force évoluent considérablement dans cette région riche en ressources énergetiques. Les puissants d’hier risquent bien de ne plus être ceux de demain. Cependant, le facteur démographique et la gestion des ressources demeureront à coup sur un frein à l’influence que ces pays pourront avoir dans la sous-région. On interprétera donc davantage leurs actes (destabilisation des régimes voisins, financements des états ou des oppositions, etc.) comme davantage des mesures défensives (On contente tout le monde dans l’espoir d’être aidé en retour, on sécurise chez le voisin dans l’espoir d’avoir la sécurité chez soi, etc.) que des réelles velléités expansionnistes.
Hors zone, on constate une même montée en puissance de l’Angola dans la région des grands lacs. La richesse colossale de ce pays issue du pétrole ainsi que l’existence d’une armée forte et disciplinée (suite à une longue guerre civile) ont donné les moyens au pays d’exercer une influence énorme dans les pays voisins (les deux Congo notamment) et d’anéantir par ricochet la rébellion de l’Unita qui opérait notamment à partir de ses appuis dans ces pays.
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
| |
 Donnez
votre opinion ou lisez les 5 réaction(s) déjà écrites Donnez
votre opinion ou lisez les 5 réaction(s) déjà écrites
 Version
imprimable de l'article Version
imprimable de l'article
 Envoyer
l'article par mail à une connaissance Envoyer
l'article par mail à une connaissance
Partager sur:
 Facebook Facebook
 Google Google
 Yahoo Yahoo
 Digg Digg
 Delicious Delicious
|
| |
| |
Les dernières photos publiées sur Grioo Village |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
 Top
Top |
| |
| |
|
| |
| |
|
  |
 |

|
|