
|
 |
  |




|
|
|
|
Un nouvel Etat |
 |
|
 |
|
 |
 |
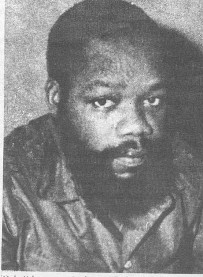 |
 |
 |
|
 |
 |
le lieutenant-colonel Odumegwu Emeka Ojukwu fait sécession
©
kwenu.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

En janvier 1962, un coup d’état porte au pouvoir le Général Johnson Aguiyi-Ironsi, de l’ethnie ibo. L’arrivée au pouvoir d’un Ibo, provoque presque immédiatement des troubles à travers le pays. Pour quelle raison ? Le Nigeria comprend trois ethnies majoritaires : les Ibos, à l’Est, les Yorubas et les Haoussas, au Nord. Les Yorubas sont majoritairement chrétiens, comme les Ibos. La différence réside dans le fait que les Ibos sont animistes à l’origine.
Ils se sont christianisés au contact des colons portugais au 15ème siècle. L’arrivée des colons anglais modifie l’équilibre. Les nouveaux colons choisissent de travailler avec les Haoussas, plus nombreux, et à leurs yeux, plus conservateurs. L’arrivée d’un Ibo à la tête du pays provoque une profonde frayeur au sein de la population, les Haoussas. Ces derniers craignent une main basse des Ibos sur tous les postes importants du pays. Des officiers haoussas se réunissent et proposent un coup d’état.
Ce qui est chose faite en juillet 1966. Les Haoussas décident de placer à la tête du pays le général Yakubu Gowon, un chrétien. Le nouvel homme fort du pays ne tarde pas à prendre une mesure très démonstrative. Les régions administratives passent du nombre de quatre à douze. La région de l’Est, à forte population ibo, est divisée en trois régions. La manœuvre a pour objectif de minimiser le « pouvoir ibo ». La réaction des Ibos ne tarde pas. Le 30 mai 1967, le lieutenant-colonel Odumegwu Emeka Ojukwu fait sécession, et ce, malgré de longues négociations. Il donne à la nouvelle région le nom de Biafra et lui attribue une capitale, Enugu. Une nouvelle nation est née.
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Des réfugiés biafrais quittant Owerri en octobre 1968
©
emeagwali.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

Le leader ibo souhaite que le Biafra soit reconnu comme un état indépendant et souverain.
Plusieurs éléments sont à la source du conflit. Déjà en 1962, l’accession au pouvoir d’un Ibo – le général Ironsi - à la tête de l’état provoque des tensions au sein des différentes ethnies. De même, le pouvoir fédéral refuse catégoriquement de voir son territoire démembré et devenir une constellation de micro états. Un autre élément entre aussi en compte : le pétrole. La région de l’Est concentre la plus grande partie du pétrole nigérian. En 1966, le futur Biafra produit 10 millions de barils par an, une manne financière que l’état fédéral n’est pas prêt à abandonner.
|
|
Un conflit d’ampleur internationale |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Le Biafra avait émis sa propre monnaie
©
emeagwali.com |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|

La rumeur d’une crise au Nigeria ne tarde pas à traverser les frontières du pays. Différents organismes internationaux tentent d’éviter le conflit qui s’annonce. L’ONU s’y essaie pour un temps, avec peu de résultats. Le jeune organisme panafricain l’OUA, Organisation de l’Unité Africaine, prend la suite de L’ONU. Pour l’institution africaine, il s’agit autant de montrer la capacité des Africains à régler eux-même leurs problèmes que d’éviter un effet tâche d’huile sur un continent dont une partie des états vient d’accéder à l’indépendance. La crise nigériane fournit pour certains la preuve que les Africains ne sont pas encore prêts à l’indépendance.
Cette thèse conforte un des états comme le Portugal dans le maintien de ses colonies sur le sol africain, ou encore la Rhodésie du Sud, dans la poursuite de son régime de mise sous tutelle. La sécession d’une patrie comme le Nigeria constituerait un précédent très lourd pour le continent africain. Dans sa charte du 25 mai 1963, l’OUA déclare intangibles toutes les frontières héritées de la colonisation. L’institution africaine veut prévenir toute velléité séparatiste. De fait, seuls quelques pays, parmi lesquels la Côte d’Ivoire, reconnaissent la jeune nation. Tous les efforts de médiation de l’OUA restent sans effets. L’Etat fédéral et le Biafra finissent par engager les hostilités.
Dans leur effort de guerre, les deux nations sont soutenues par différents alliés. L’URSS et la Grande-Bretagne, adversaires politiques sur le plan international, soutiennent l’Etat fédéral tandis que les Français et les Américains soutiennent le Biafra. Officiellement, les alliés du Biafra fournissent un soutien humanitaire. Officieusement, malgré les dénégations de part et d’autres, le soutien est tout autant militaire. La guerre qui s’engage devient de fait « une guerre civile internationalisée ».
|

Avant tout, Le conflit biafrais reste une guerre civile. Malgré toute leur opiniâtreté, les sécessionnistes finissent par céder face aux offensives du gouvernement fédéral. Ce dernier prend position tout autour du Biafra et lui coupe son accès à la mer. L’étranglement est total. La situation se dégrade inexorablement pour les sécessionnistes. De longs mois s’écoulent durant lesquels les Biafrais meurent de faim et de maladie par milliers.
Ce n’est qu’en 1968 que le sort des Biafrais finit par ne plus être ignoré. Le monde occidental découvre sur ses écrans de télévisions des enfants biafrais sous-alimentés, les cheveux jaunis par la dénutrition et le ventre gonflé par le kwashiorkor. La même année, la presse écrite française relaie des témoignages poignants et révoltés sur le martyr des Biafrais. Dans l’indifférence générale, une crise humanitaire de taille se déroule à quelques heures d’avion. De jeunes médecins français se rendent au Biafra pour soigner et soutenir le peuple. Ce sont eux qui créeront l’association Médecins Sans Frontières.
De nombreuses associations humanitaires tirent la sonnette d’alarme pour informer l’opinion publique de la situation sanitaire catastrophique du « réduit biafrais ». Un gigantesque mouvement humanitaire se crée pour venir en aide au peuple biafrais. La crise zaïroise et la sécession du Katanga n’ont pas suscité un tel élan humanitaire. Pourtant, la situation de la population zaïroise ne s’avère pas moins dangereuse à l’époque. Des associations catholiques, protestantes, athées, françaises, américaines et allemandes se mettent en contact pour acheminer vivres et denrées de premières nécessités. Le gouvernement fédéral ne facilite pas les livraisons qui se font souvent de nuits, sur des aéroports de fortune. Malgré toute la bonne volonté internationale, le territoire biafrais recule tous les jours. Il n’est bientôt plus question que du « réduit biafrais ».
|
|
Un génocide ? |

Comment qualifier le conflit biafrais ? Peut-on parler de crise purement ethnique et de là tirer la conclusion que les Ibos ont été victimes d’un génocide ? Peut-on parler de lutte de pouvoir ? Il est indéniable que les Ibos ont été les principales victimes du conflit. Durant la guerre, entre 2 et 3 millions de personnes sont mortes. Sur ce total, 15 à 20 % de la population du Biafra a disparu, tuée en grosse partie par la maladie et la famine. Pour autant, il est difficile, voire impossible de prouver que le gouvernement voulait massacrer toute la population ibo et uniquement celle-ci. Au contraire, pour le président biafrais, un génocide a bien lieu au Biafra. Les différents observateurs internationaux soutiennent au contraire qu’il n’y a pas eu de génocide. Le gouvernement n’a fait preuve à aucun moment d’un acharnement particulier à exterminer les Ibos.
|

L’objectif militaire reste identique du début à la fin du conflit : briser la résistance des sécessionnistes et réunir la nation nigériane dans son ensemble. A la fin de la crise, l’Etat fédéral réintègre pleinement tous les officiers ibos. Aucune représailles n’ont été exercées à l’encontre des Ibos séparatistes. Le gouvernement fédéral nigérian a souhaité avant tout faire preuve de compréhension et peut-être montrer aux Africains et au monde, son unité. La crise du Biafra comprend aussi une dimension très politique. La spécificité du conflit tient plus de l’ « ethnicisation » de la question politique. Durant la colonisation, les Anglais ont favorisé les gens du Nord, les Haoussas, au détriment du reste de la population. Ce favoritisme a créé un sentiment d’injustice chez les Ibos, l’arrivée au pouvoir d’un Ibo en la personne D’Ironsi est une des marques de cette frustration. Avant la crise du Biafra, les Haoussas et les Ibos veulent à tous prix placer à la tête du pays un des leurs pour conserver l’initiative politique.
Le 12 janvier 1970, après la fuite d’Ojukwu, le premier ministre du défunt Biafra signe un cessez-le-feu immédiat. Il scelle ainsi la fin du Biafra. L’Etat fédéral nigérian reprend ses droits dans un territoire meurtri. Un lourd bilan : une catastrophe humanitaire et 2 millions de morts. Le pétrole a permis la reconstruction matérielle du pays, mais pas identitaire. La crise a mis en lumière un des maux du pays, la question de l’ethnie. Le Nigeria d’aujourd’hui semble impuissant à régler cette question. Quasiment 30 ans après la signature du cessez-le-feu, les leçons du conflit civil nigérian semblent toujours d’actualité.
|

|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
| |
 Donnez
votre opinion ou lisez les 1 réaction(s) déjà écrites Donnez
votre opinion ou lisez les 1 réaction(s) déjà écrites
 Version
imprimable de l'article Version
imprimable de l'article
 Envoyer
l'article par mail à une connaissance Envoyer
l'article par mail à une connaissance
Partager sur:
 Facebook Facebook
 Google Google
 Yahoo Yahoo
 Digg Digg
 Delicious Delicious
|
| |
| |
Les dernières photos publiées sur Grioo Village |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
 Top
Top |
| |
| |
|
| |
| |
|
  |
 |

|
|